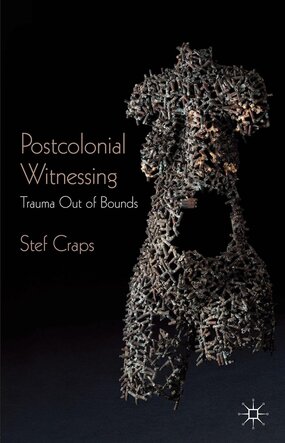Comme son titre le suggère, Postcolonial Witnessing. Trauma Out of Bounds revendique une « perspective postcoloniale » (p. 7) tout en s’inscrivant avec force dans le champ des trauma studies avec lesquelles il engage un dialogue très étroit, à la fois critique et réformateur.
« Décoloniser les trauma studies »
Les trauma studies sont nées dans le courant des années 1990 de l’intérêt d’universitaires américains, provenant principalement des études littéraires et des sciences humaines, pour la catégorie de trauma, alors appréhendée à partir de réflexions sur les catastrophes historiques, majoritairement sur la Shoah. Dès les années 2000, ces études interdisciplinaires sont l’objet d’un mouvement réflexif et critique d’importance. Initié et nourri par les travaux de Ruth Leys, Roger Luckhurst, Michelle Balaev ou encore Susannah Radstone, celui-ci passe au crible les fondements théoriques et méthodologiques du champ. Postcolonial Witnessing s’inscrit dans cette veine tout en y traçant une voie particulière. L’ouvrage reprend en effet à son compte le projet de « décoloniser les trauma studies » (Rothberg 2008 ; Visser 2015), tel que formulé en 2008 dans un numéro spécial de la revue Studies in the Novel, « Postcolonial Trauma Novels », co-dirigé par Stef Craps et accueillant les contributions de quelques figures connues des trauma studies (dont Michael Rothberg et Anne Whitehead). Ce projet repose sur deux objectifs principaux : ouvrir le champ d’études à la littérature postcoloniale – que celui-ci a, jusque-là, peu prise en compte voire totalement ignorée – afin de reconnaître pleinement, et dans toutes leurs spécificités, les expériences traumatiques « non occidentales », notamment celles liées à l’oppression coloniale (dépossession, migration forcée, diaspora, esclavage, racisme, violence politique, génocide) (Buelens & Craps, 2008, p. 2-3) ; et questionner, à partir de ces dernières, les impensés et les angles morts des trauma studies (leurs implications idéologiques comme leurs « biais occidentaux ») afin de « réviser et d’élargir les définitions du trauma » (Buelens & Craps 2008, p. 4).
Avec Postcolonial Witnessing, Stef Craps reprend peu ou prou ce programme en lui donnant une plus grande ampleur, et ce, sur deux terrains étroitement liés : l’un principalement épistémologique et théorique (auquel sont consacrés les chapitres 1, 2, 3 et 6), l’autre dédié à l’analyse d’œuvres littéraires issues de différentes aires culturelles et géographiques (chapitres 4, 5, 7 et 8). Ces analyses portent sur le roman épistolaire de Sindiwe Magona, Mother to Mother (1998), qui explore les effets de la colonisation et de l’apartheid en Afrique du Sud ; sur deux textes consacrés à l’esclavage, « Turner » de David Dabydeen (1995) et Feeding the Ghosts de Fred d’Aguiar (1995) ; sur plusieurs textes de Caryl Phillips qui nouent des liens entre les violences historiques racistes et antisémites ; enfin sur le roman Baumgartner’s Bombay d’Anita Desai (1988) qui explore la complexité des entrelacs entre les parts traumatiques des histoires européenne et asiatique. À partir de l’étude de ces textes, Stef Craps s’attache à pointer les limites et les lacunes des approches traditionnelles du trauma, de la mémoire, du deuil et de la guérison et à en déployer une nouvelle compréhension. Récusant l’idée solidement ancrée dans les trauma studies que certaines esthétiques (en l’occurrence l’esthétique « moderniste ») seraient plus à même de rendre compte de manière appropriée du trauma (p. 41), l’ouvrage tente de mettre en relief la « diversité des stratégies de représentation » élaborées par les œuvres dans des contextes historiques et culturels spécifiques (p. 43), et notamment en lien avec la nature et la temporalité particulières du trauma colonial. Plus généralement, et sur un plan à la fois épistémologique et esthétique, il s’agit pour Stef Craps de proposer et de soutenir des « paradigmes alternatifs […] au modèle événementiel du trauma » façonné par l’Occident (p. 4).
Enjeux éthiques
La pierre angulaire de l’argumentation de Stef Craps est d’ordre éthique : depuis leur émergence, comment les trauma studies ont-elles conçu leur portée éthique ? L’ont-elles toujours mise réellement en œuvre ? Dès l’introduction, il revient ainsi sur place accordée à l’éthique dans les textes fondateurs du champ, principalement ceux de Cathy Caruth. Il rappelle que cette dernière, au début des années 1990, avait vu, dans le fait de s’intéresser à la nature traumatique de l’Histoire, un moyen de contrer les accusations de « paralysie éthique et politique » adressées aux études littéraires nord-américaines (p. 1), alors très influencées par les approches textualistes et la réception de la déconstruction derridienne aux États-Unis (voir Bond et Craps 2019). Il insiste en outre sur le fait que le « nouveau mode de lecture et d’écoute » exigé par le trauma, selon Cathy Caruth, est envisagé par cette dernière comme une manière de « rompre l’isolement que l’expérience traumatique impose tant aux individus qu’aux cultures […] et que, parce qu’il constitue un lien entre diverses expériences historiques […], écouter le trauma de l’autre peut contribuer à une solidarité interculturelle et créer de nouvelles formes de communauté » (p. 2). Or, pour Stef Craps, c’est justement cette « promesse […] éthique » que la première génération de théoriciens des trauma studies n’a pas su tenir. Selon lui, ils ont échoué sur quatre points :
Ils marginalisent ou ignorent les expériences traumatiques des cultures non occidentales ou minoritaires, ils tendent à prendre pour acquit la validité universelle des conceptions du trauma et de la guérison issues de l’histoire de la modernité occidentale, ils favorisent souvent, voire prescrivent, une esthétique moderniste de la fragmentation et de l’aporie comme la seule apte à témoigner du trauma, et ils ignorent généralement les relations entre les expériences traumatiques dans les puissances coloniales et celles des cultures non occidentales ou minoritaires. (p. 2)
De ce point de vue, le désir de « solidarité interculturelle » exprimé initialement par les trauma studies se révèle être, au mieux, un vœu pieux : ces dernières ne s’étant pas donné les moyens d’enrayer ni même de mettre au jour « les croyances, les pratiques et les structures qui entretiennent les injustices et les inégalités existantes » (p. 2). Cependant, Stef Craps refuse, pour ainsi dire, de jeter le bébé avec l’eau du bain, convaincu que la théorie du trauma n’est pas irrémédiablement corrompue par ses biais occidentalo-centrés (p. 33) et, qu’une fois révisée, elle « peut aider à identifier et à comprendre des situations d’exploitation et d’abus, et servir de levier pour une critique nourrie et globale des conditions sociales » (p. 126). Ainsi, à travers la relecture critique qu’il fait des textes pionniers, les analyses tirées de son corpus littéraire, et la mobilisation de notions fructueuses telles que celles d’« insidious trauma » ou de « multidirectional memory », l’ouvrage promeut plutôt une reconfiguration et une réorientation des trauma studies afin que ces dernières puissent pleinement réaliser leurs aspirations éthiques initiales.
L’ouvrage n’échappe pas à quelques écueils, liés à cette demande contradictoire qu’il fait aux trauma studies « de modifier leurs postulats de base tout en devenant plus fidèles à elles-mêmes » (Rothberg 2013), et se satisfait parfois d’une vision un peu binaire, éludant notamment des nuances fondamentales pour le champ (comme les différences et les tensions entre psychanalyse et psychiatrie). Malgré cela, il constitue un apport très précieux, tant par la synthèse qu’il offre des critiques adressées aux ouvrages fondateurs des trauma studies, que par les renouvellements théoriques et méthodologiques qu’il met en œuvre à partir de son approche postcoloniale.
Alice Laumier - Université de Toronto
La traduction des citations a été réalisée par l’autrice de la recension.
Bibliographie :
-
Michelle Balaev, « Trends in Literary Trauma Theory », Mosaic : An Interdisciplinary Critical Journal, 2008, vol. 41, n° 2, p. 149-165.
-
Lucy Bond & Stef Craps, Trauma, New York/London, Routledge, 2019.
-
Gert Buelens & Stef Craps, « Introduction », Studies in the Novel, 2008, vol. 40, n° 1/2, p. 1-12.
-
Ruth Leys, Trauma : A Genealogy, Chicago, University of Chicago Press, 2000.
-
Roger Luckhurst, The Trauma Question, New York/London, Routledge, 2008.
-
Susannah Radstone, « Trauma Theory : Contexts, Politics, Ethics », Paragraph, 2007, vol. 30, n° 1, p. 9-29.
-
Michael Rothberg, « Decolonizing Trauma Studies : A Response », Studies in the Novel, 2008, vol. 40, n° 1/2, p. 224-234.
-
Irene Visser, « Decolonizing Trauma Theory : Retrospect and Prospects », Humanities, 2015, vol. 4, n° 2, p. 250-265.
Œuvres littéraires mentionnées -
David Dabydeen, Turner : New and Selected Poems [1995], Leeds, Peepal Tree, 2002
-
Fred D’Aguiar, Feeding the Ghosts [1995], London, Vintage, 1998.
-
Anita Desai, Baumgartner’s Bombay [1988], London, Vintage, 1998.
-
Sindiwe Magona, Mother to Mother [1998], Boston, Beacon, 1999.
-
Caryl Phillips, The European Tribe, London, Faber and Faber, 1987.
-
Caryl Phillips, Higher Ground : A Novel in Three Parts, New York, Viking Penguin, 1989.
-
Caryl Phillips, The Nature of Blood, London, Faber and Faber, 1997.