Le 18 mars 1992 a été publié un arrêté introduisant un module obligatoire de sciences humaines et sociales dans les études médicales. Depuis, les sciences humaines et sociales, souvent enseignées par des professionnels issus de philosophie, sociologie, histoire, anthropologie ou encore la géographie accompagnent les étudiant·e·s et les soignant·e·s dans leur professionnalisation.
Initialement cantonnées en début de cursus, les réformes récentes (notamment la réforme du 2e cycle des études médicales, « R2C », ont réaffirmé l’importance des sciences humaines et sociales dans la formation médicale.
Ainsi, depuis 30 ans, les sciences humaines et sociales en santé - ou humanités médicales - permettent aux futur·e·s professionnel·le·s de santé d’aborder leur formation et leur future profession autrement que par la seule lecture biomédicale de la maladie, du soin et des pratiques médicales en les inscrivant pleinement dans les enjeux éthiques, historiques, philosophiques, politiques ou encore sociaux. Elles contribuent à la construction d’un esprit critique et à la réflexivité qui leur permettent d'interroger les savoirs enseignés et pratiques professionnelles.
La pandémie de la Covid-19 a encore une fois souligné la pertinence des sciences humaines et sociales. Par exemple, elles permettent d'expliquer autrement que par la polémique les dynamiques sociales à l'œuvre dans ce qui est pudiquement appelé "hésitation vaccinale" mais qui de fait expriment un refus de la demande de se faire vacciner.
C'est notamment en temps de crises, qui constituent des mises à l’épreuve des corps, des gestes et des pratiques de soins, que les chercheur·se·s en SHS se montrent d'indispensables analystes, interprètes et traducteur·ice·s du monde en mouvement, là où les sciences naturelles et biomédicales ne peuvent pas éclairer le social. Ils amènent à les questionner, les adapter ou encore les transformer.
En réactivant ces questionnements, il s'agit aussi de les inscrire dans la durée, en s'intéressant notamment à l'exemple des crises passées. Rarement l'intérêt de professionnel·les de santé mais aussi des citoyen·nes pour l'histoire des épidémies a été aussi grand qu'au début de la pandémie de la Covid-19 où les autres sciences n'avaient que peu d'éléments à apporter sur la manière dont une société devait gérer une épidémie aux contours inconnus et si incertaines.
Quelle place accorder à la mémoire ? Comment, au-delà de l’instantanéité d’une crise, la mémoire peut-elle impacter ces gestes et ces pratiques ? Comment rendre compte de cette mémoire et s’en servir d’appui pour permettre aux futurs professionnels de santé de saisir dans quel système ils sont amenés à prendre place ? Cet anniversaire des humanités médicales est ainsi l'occasion de réinvestir cette question des temporalités, tout en mettant à l'épreuve la construction de cet esprit critique qu'elles ont promu pendant trente ans.
Les thématiques abordées pourront être les suivantes (sans s’y limiter) :
- Vécus et expériences : Il convient d'étudier et de comprendre l'impact des moments de crise sur les gestes et pratiques en santé, tant au moment même de la crise qu'après sa résolution, sur des temporalités différentes.
- Matérialités de maladies, du soin et des soignant·e·s : Les moments de crise sont aussi des situations de bouleversements matériels, ce qui incite à penser les humanités médicales par le prisme des instruments, des objets, du patrimoine médical.
- Mémoires et oublis : Vécus différemment par les acteur·ices de la société, les moments de crise sont un intéressant laboratoire pour saisir la coexistence de temporalités différentes et complémentaires, pour questionner les différentes formes de mémoires (patient·es et soignant·es, mémoire des environnements pollués, antibiorésistance, etc).
- Pédagogie (S)HS : Enfin, ces moments de crise peuvent aussi mettre l'acte de la transmission en question. Il s'agit ici de réfléchir plus largement aux interactions entre pédagogie et humanités médicale, en présentant projets et expériences.

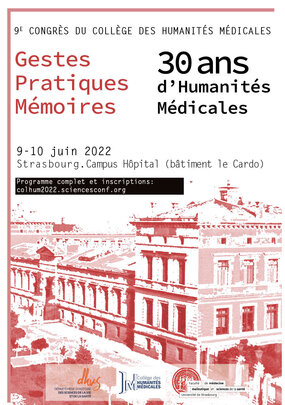
![[Translate to English:]](/websites/_processed_/0/4/csm_signature-unistra_9b5f16fc46.png)
![[Translate to English:]](/websites/_processed_/8/4/csm_logo-uha_827246ff15.png)
![[Translate to English:]](/websites/_processed_/0/e/csm_logo-cnrs_791a922340.png)
![[Translate to English:]](/websites/_processed_/1/1/csm_logo-rnmsh_3dacb03b13.png)