Cette journée d’études constitue une première étape dans l’élaboration d’une réflexion collective, par la mise en commun des concepts et analyses, réflexion qui a vocation à s’ouvrir à d’autres problématiques concernées par les récits et politiques illibérales. De nombreuses thématiques pourront dans des phases ultérieures être explorées dans le prolongement de ces propositions de réflexion concernant autant les reconfigurations économiques, (en lien avec certaines formes de capitalisme) sociales, politiques et écologiques.
ILLIBERALISME(S) ET DEMOCRATIE
Comment penser aujourd’hui l’illibéralisme, notion protéiforme, qui a connu un développement de ses usages politico-médiatiques en particulier à travers la référence à une forme de « démocratie illibérale », mais aussi notion renvoyant à de multiples domaines du social (politique, économique, juridique, écologique..) ?
Le terme comme ses usages font l’objet de nombreuses critiques. Sont par exemple soulignées l’absence de consensus dans sa définition tout comme dans celle du libéralisme (Demias- Morrisset, 2024), la difficile périodisation des phénomènes désignés, mais aussi leurs rapports complexes à la démocratie, contestation de l’extérieur ou de l’intérieur à travers en particulier la remise en cause de l’État de droit ou de normes internationales qui viendraient remettre en cause les souveraineté nationales (Chevallier, 2024 ; Rrapi, 2025). C’est encore l’instrumentalisation euphémisante du terme illibéralisme qui est dénoncé, parmi « des concepts insensés, comme démocratie « illibérale », autoritarisme démocratique et « démocrature », qui font croire que puisse exister une démocratie sans liberté et sans égalité » (Alduy, Collovald, Pranchère, 2023).
Quelques problématiques et caractéristiques transversales émergent de ces travaux, permettant d’esquisser des éléments d‘une définition provisoire.
D’une part, l’illibéralisme renvoie, dans tout ce qui est énoncé ci-dessus, à la fois à des formes institutionnelles ou à la critique de formes institutionnelles, mais aussi à un narratif.
Ainsi, concernant la « démocratie illibérale », si elle entend être réduite « aux processus électifs, en allégeant le poids des contraintes juridiques » (Chevallier, 2024), elle s ‘appuie aussi sur un récit mettant en avant la supposée vraie voix du peuple, souvent contre les élites ou les minorités actives ; dans ce cadre, est dénoncé la primauté du « droit des individus » (défendu par un supposé gouvernement des juges) contre « l’intérêt de la nation » (Mathieu, 2024). Il s‘agit de se référer à un mode de gouvernement qui, par référence à la volonté populaire, ne veut pas connaitre de règles à respecter ni de contraintes dans son action (Rrapi, 2025.) Émerge ainsi une communauté nationale ou une communauté des citoyens en danger, vision organiciste souvent représentée ou confondue avec le(s) dirigeant(s), « efficace et intransigeant, mais également proche du peuple et loin de l’élite intellectuelle ou artistique. » (Cetin, 2023)
Ces récits comme ces volontés politiques, présents dans l’ultra contemporanéité, paraissent pouvoir être mis en dialogue avec d’autres périodes. Est-il possible d’interroger des spécificités mais aussi des héritages dans des contextes où les enjeux politiques économiques, sociaux et culturels sont bien différents mais où les moyens répressifs, les justifications idéologiques et les objectifs autoritaires font singulièrement écho aux années 2020 ?
Enfin, les illibéralismes sont aussi souvent marqués par une remise en cause de certains savoirs académiques et de leur légitimité (Behr, 2021), en témoigne le succès de l’expression de « wokisme », terme relevant d’une bataille sémantique caractéristique des logiques conservatrices et fortement reprise par les médias (Gautier, Zancarini-Fournel, 2022). Cette remise en cause des savoirs critiques se traduit concrètement par un contrôle de plus en plus important des politiques publiques, allant jusqu’à la main-mise du pouvoir sur les contenus comme le montre l’exemple étatsunien, le domaine du savoir et de l’enseignement constituant des lieux forts de mobilisation illibérale (Szukala, Proeschel, 2025)
Dans ce cadre, les politiques favorisant l’égalité et les libertés de genre, tout comme celles favorisant une laïcité ouverte, sont attribuées à des « élites » considérées comme trop éloignées des intérêts de la population majoritaire dans l'espace démocratique. Ces « élites » sont dénoncées comme suivant un plan visant à imposer un modèle de société qui va à l'encontre des valeurs des parents/de la famille, du « bon sens » ou des intérêts du « pays réel ».
C’est au prisme de ces deux dimensions, les questions de genre et les questions de laïcité, que cette journée d’étude souhaite participer à la réflexion collective sur l’illibéralisme, tant les dynamiques, les acteurs et actrices qui les caractérisent s’entrecroisent (Paternotte et alii, 2015). Que ce soit dans une confrontation frontale à des normes religieuses ou à des conservatismes sécularisés, les processus d’émancipation concernant le genre sont considérés comme contraires à des hiérarchies naturelles au profit du masculin elles-mêmes étroitement liées aux autres inégalités pensées comme intangibles. L’hostilité au multiculturalisme, au pluralisme religieux va de pair avec le refus de la reconnaissance des pluralités de genre et de sexualités, ces projets de société refusant la dissociation des normes civiles et des normes confessionnelles explicites ou implicites.
Centrée à la fois sur l’étude des récits et des politiques publiques, cette journée d’étude se propose d’aborder les problématiques suivantes à partir d’études de terrain et d’approches théoriques :
-
l’usage et l’instrumentalisation de la laïcité, de la place ou des droits des femmes et des questions de genre au service de configurations sociales ou de visions identitaires de la société : par exemple comment se développent des mobilisations contre la notion et le concept de genre, mais aussi comment les questions de genre sont mobilisées dans une rhétorique ou un projet d’illibéralisme, en lien avec quelles autres inégalités ?
-
la manière dont la question de la gestion de la diversité, des minorités ou du pluralisme croise les questions laïques et les questions de genre, l’hypothèse d’une similarité dans la volonté d’imposer une uniformité sexuelle et une uniformité religieuse ;
-
les implications en matière d’égalité citoyenne et de respect des droits ;
-
le rapport ambigu à la science, à la biologie, à la nature, comme vecteurs de remise en cause de certains savoirs et de politiques anti-discriminatoires ;
-
les relations des récits, politiques et acteurs relations aux institutions religieuses ;
Conseil scientifique :
Séverine Mathieu, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris
David Paternotte, Université Libre de Bruxelles
Stéphanie Tremblay, Université du Québec à Montréal
Stéphanie Wattier, Université de Namur
Michele Zancarini-Fournel, Université Lyon 1

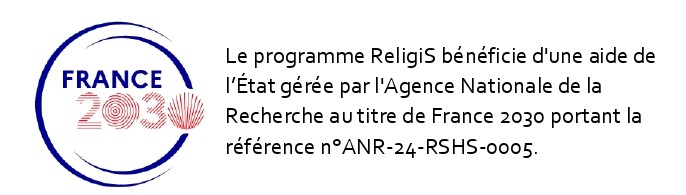
![[Translate to English:]](/websites/_processed_/0/4/csm_signature-unistra_9b5f16fc46.png)
![[Translate to English:]](/websites/_processed_/8/4/csm_logo-uha_827246ff15.png)
![[Translate to English:]](/websites/_processed_/0/e/csm_logo-cnrs_791a922340.png)
![[Translate to English:]](/websites/_processed_/1/1/csm_logo-rnmsh_3dacb03b13.png)